

Sauveur Carlus
graphiste, illustrateur, peintre, auteur, compositeur, interprète

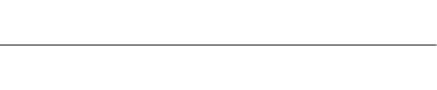
Prisonniers d'une étoile
Couverture
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
L'arrivée au manoir
L'incendie du manoir
Quand Paul pointa enfin le bout de son nez hors de la couette, il était déjà sept heures trente ! Pourquoi l’horloge n’avait-elle pas sonné ? L’avait-il au moins réglée hier soir ? N’avait-il pas plutôt retardé l’alarme d’un geste machinal ? L’angoisse l’assaillit d’emblée de questions alors qu’il sautait déjà de son lit et courait sous la douche. La vaine et fébrile rapidité de ses membres le rendait encore plus pitoyable. Malgré la brutalité de son réveil, son corps ne parvenait pas, de toute évidence, à se délester du sommeil profond dans lequel il était encore plongé quelques secondes auparavant. Victime de tournis et d’aigreurs d’estomac, Paul se lava, s’habilla et sortit, tel un robot, pour se rendre à son travail relativement à l’heure.
Cette nuit, il avait rêvé. De quoi ? Il ne savait plus trop. Ç’avait un rapport avec son boulot.
Le vent déroula soudain dans la rue son haleine de givre. Rien ne lui résista. Paul, recroquevillé misérablement sous l’abri bus, fut saisi par la rafale. Le froid aurait alors pu le réveiller pour de bon, mais celui-ci, trop vif, ne fit que le statufier davantage dans sa torpeur.
Impossible alors d’y voir clair. De quoi parlait le rêve ? S’il était question de son boulot, c’était plutôt un cauchemar…
Paul ne jouissait pas de nuits sereines. Il dormait peu. Ses insomnies duraient parfois jusqu’aux premières lueurs du jour. Pas difficile alors de comprendre, dans ces conditions, pourquoi avait-il été encore sourd ce matin à l’alarme de son réveil. Succombant plus à une lassitude de son corps due à une trop lourde veille qu’à un sommeil ancré dans un équilibre biologique, Paul ne pouvait à cet instant précis du lever plus rien percevoir. Son repos nocturne ne bénéficiait plus que de quelques minutes pour le véhiculer de palier en palier. Cette descente trop abrupte dans les abysses de l’inconscient, prenant alors le risque de jongler à la fois avec tous les éléments insondés et sulfureux du cerveau, avait pour principale conséquence de faire sombrer Paul dans un monde encore plus obscur. Si tout rejoignait le rêve, tout s’exprimait alors de façon beaucoup plus chaotique.
Le bus chargé de buée apparut enfin. Paul s’y engouffra. La continuité du rêve lui échappait. Peut-être ce dernier n’en avait-il pas eu. Seulement des images isolées : des cartons qu’il fallait ouvrir et dans lesquels d’autres cartons fermés attendaient à leur tour d’être ouverts, un cochon – pourquoi un cochon ? – prisonnier, comme un taureau l’est d’une arène, de deux rayonnages couverts de vaisselle…
Hier, Paul avait reçu la nouvelle collection des services à sushis. Le Japon se vendait actuellement comme des petits pains ; il fallait s’empresser de creuser ce filon commercial. Il était évident que son rêve se rapportait directement à son activité de la veille. Toute une journée à coller des étiquettes, à référencer et répertorier chaque article, ça ne pouvait que marquer l’esprit ! Paul en avait tellement marre de ce boulot. Tourner et virer parmi les rayons, attendre les clients, servir, renseigner, garder le sourire, placer, replacer, déplacer, remplacer des assiettes, des verres, des fourchettes, des cuillères et des couteaux…
C’était aux heures d’affluence, alors que les consommateurs envahissaient l’espace, que tout s’agitait soudain d’un horrible mouvement de vie. Paul reconnaissait désormais très clairement les signes avant-coureurs des hallucinations dont il était régulièrement victime. Les premières mesures étaient à chaque fois battues par les baguettes chinoises sur le dos des saladiers. Un, deux… puis venait le tour des flûtes à champagne, trois, quatre… et celui des fins gobelets aux voix cristallines. Alors, tout reprenait, tout s’amplifiait. Un, deux… les râpes à fromage, les tire-bouchons, les économes raclaient le fond de leurs gorges pour unir leurs timbres de crécelles, trois, quatre… les torchons et les serviettes, mélangés pour l’occasion, déployaient leurs ailes chiffonnées et tournoyaient au-dessus de Paul comme des rapaces prêts à l’assaut. Un, deux… les marmites barytons se mettaient à rugir en chœur, tandis que, trois, quatre… les tagines ouvraient larges leurs coffres de ténors.
La cacophonie durcissait, les cris s’acéraient, et c’était toujours au paroxysme de ce vacarme que déboulait – comme s’il était encore possible d’ajouter à l’horreur – le chant rauque des solistes que Paul connaissait si bien et qu’il redoutait tant. Le manager, les assistants, la délégation du siège, tous se réunissant en une chorale infernale, tous essayant d’élever plus haut que leurs voisins leurs voix graves ou aiguës, mais toujours fausses, éraillées ou stridentes : « Il y a un problème de shift au niveau de la caisse ! », « As-tu respecté les consignes concernant les top display ? », « Toujours se soucier du réassort, voilà la règle d’or du parfait vendeur ! »
Le bourdonnement de ce jargon percutait les tempes de Paul. Ce dernier cédait à ce charabia hypnotique. L’entendement humain tout entier semblait devoir se dissoudre dans cette bouillie de mots barbares. Paul n’avait plus qu’à attendre que ses vertiges se dissipent. Tout redevenait alors comme avant. La réalité n’était malheureusement pas moins absurde et entêtante que les délires. Paul se retrouvait de nouveau au milieu de ses rayons de porcelaine, perdu entre la masse acheteuse, matérielle et oppressante des clients et le reste du personnel modelé de la tête aux pieds à l’esprit de la maison.
Il fallait que Paul l’accepte : sa vie, c’était la boutique. Il se devait de respirer, de manger et même de penser la philosophie de l’entreprise dont il était un des employés. Tout de lui devait l’émaner. Celle-ci n’était-elle pas d’ailleurs à ce jour parvenue à s’immiscer jusque dans les plis les plus reculés de ses rêves ?
Paul mesurait bien, là, le désastre de son existence, mais il n’était pas sans savoir non plus que lui seul restait maître d’œuvre de sa propre capitulation. Quel miracle, en effet, aurait-il pu attendre ? Les puissances extérieures, Dieu, les anges, les bonnes fées, tout ça n’existait pas ; quant aux forces intérieures, il y avait belle lurette que ces dernières l’avaient déserté. Paul vivait chacun de ses jours sans penser au suivant. À en croire alors un tel désenchantement de sa part, peut-être n’était-il plus que l’ombre de lui-même, un être sans consistance, un simple corps enfin abandonné de son âme et s’obstinant sans raison apparente à hanter encore un peu la surface du globe.
Cependant, à présent trop embourbé d’apathie, Paul ne pouvait plus réfléchir clairement à toutes ces questions. À peine le suicide lui était-il en effet apparu comme une des seules solutions restantes que ce dernier ne put être plus longuement envisagé tant fallait-il encore, pour se tuer, pouvoir faire preuve d’une certaine organisation dans les idées et les actions. Paul, à vrai dire, avait même perdu jusqu’à ces dernières facultés essentielles.